Cet entretien a été réalisé au début de l’année 1980 pour être publié dans le catalogue de l’exposition « Nice à Berlin » qui s’est tenue du 16 mai au 13 juillet 1980 à la DAAD Galerie de Berlin. Elle réunissait de nombreux artistes de Nice et de sa région et proposait un panorama de la création contemporaine.
L’entretien s’est déroulé au domicile de Martine Doytier, au 18 rue de la Préfecture à Nice, et a été conduit par quatre personnes : Frédéric Altmann, Christian Arthaud, Katy Rémy et Marc Sanchez.
Une version abrégée du texte a été publiée dans le catalogue de l’exposition de Berlin et la version publiée ici constitue la version intégrale de l’entretien. A l’occasion de cette nouvelle publication, le texte a été divisé en quatre parties, augmentées chacune d’un titre et de diverses photographies.
Dans le catalogue de « Nice à Berlin », le texte était accompagné de la photographie du tableau « Le Facteur Cheval ».
Marc Sanchez
Q : Martine Doytier, chacun de vos tableaux apparaît comme une aventure dans laquelle vous vous engagez après avoir mûrement réfléchi. Avez-vous parfois des problèmes d’inspiration ou de choix ?
R : Non, pas du tout. En réalité, la peinture n’est pas quelque chose que je fais parce qu’il faut faire un tableau, par exemple, pour prouver que je suis peintre, pour accéder au statut d’artiste ou pour exister face à ceux que je rencontre. Pour moi, c’est quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie, comme manger, dormir, respirer et je serais incapable de faire autre chose. Je pense que je ne remettrai pas la peinture en question un jour ou alors c’est que je deviendrai totalement tranquille, sereine.
Q : Elle est donc liée à votre angoisse ?
R : Absolument. Et si un jour je n’éprouve plus le besoin de peindre, cela voudra dire que j’aurai trouvé une forme d’équilibre, que je me sentirai mieux.
Q : Qu’est-ce que cela représente pour vous d’être une artiste ?
R : Je n’ai pas l’impression d’être une artiste. J’ai plutôt l’impression d’être une personne qui est, ou trop mal, ou trop bien et qui regarde le monde dans lequel elle vit. C’est tout cela qui implique que je fais de la peinture.
Q : Je crois que vous avez dit un jour : « on devrait pouvoir retourner l’être humain comme on retourne un gant ». Pouvez-vous préciser le sens de cette phrase ?
R : Il est bien évident que l’idée de me faire retourner comme un gant est vraiment une idée insupportable mais, à la limite, pourquoi pas ? Je crois que la seule audace que j’ai par rapport à beaucoup de ceux qui m’entourent est d’arriver à montrer l’autre face de moi-même et à dire « je suis çà ». Quand je suis devant une de mes toiles, pour ceux qui me regardent, le gant est à l’envers. Dans ma vie, j’ai des tas de possibilités de faire croire à ce que je ne suis pas, excepté quand je peins.
Q : Comment se déroule la réalisation d’un tableau ?
R : Il y a toujours une période où je ne peins pas, où je ne fais que m’alimenter, me nourrir de tout ce que je vois, de tout ce que je vis. Mais cela est dû à une provocation du monde extérieur. On m’y oblige et cela peut durer plusieurs mois. C’est peut-être la période la plus importante. Puis, il y a le moment – et je n’ai pas toujours l’impression d’y être pour quelque chose – où je me retrouve nez-à-nez avec le besoin de reprendre mes pinceaux. À partir de ce moment, j’entre dans la toile, en commençant toujours par peindre un œil. J’avance lentement, je m’obstine sur des détails car, pour moi, ils sont essentiels. Puis, parfois après plusieurs mois de travail, il se passe une sorte de déclic et, soudain, je comprends pourquoi je suis là depuis six mois. Je sais alors exactement où je vais et, quelque part, je suis contente car alors je me connais un peu mieux moi-même, je sais pourquoi j’ai fait ce parcours, j’en entrevois le but.
Q : Vous voulez dire que vous découvrez votre tableau en le faisant ?
R : Oui et non. Car je sais que j’ai tout en moi quand je le commence. Je sais tout ce qui va s’y passer, je connais parfaitement le déroulé de l’histoire, mais ce « déclic » est important car, à partir de ce moment, je sais pourquoi je fais ça, pourquoi je me suis obstinée.
(à suivre…)
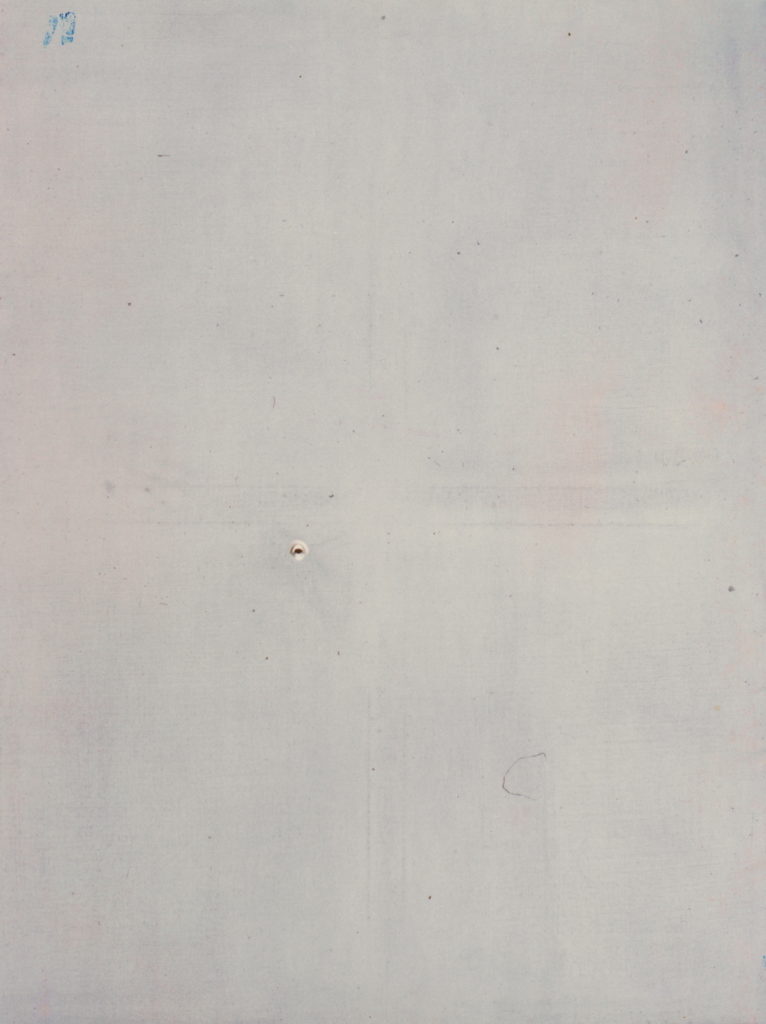
Début de la peinture du tableau de Martine Doytier, « Les Autres », 1976-1977, huile sur toile, 130 x 97 cm.

Détail du premier œil du tableau « Les Autres »

Martine Doytier, « Les Autres », 1976-1977, huile sur toile, 130 x 97 cm. Collection privée.
Q : Vous avez dit que les détails étaient quelque chose d’essentiel pour vous.
R : Oui, car lorsque je peins un tout petit détail, comme cette main d’un centimètre carré, c’est comme si j’écrivais un paragraphe d’un roman. Personne ne le vois, personne ne s’en rend compte, mais cela existe. C’est peut-être cela ma force.
Q : Je pense que la toile sur le Facteur Cheval illustre parfaitement ce désir de précision.
R : Vous savez, il y a une partie du Palais du Facteur Cheval qui est bourrée de détails, qui fourmille de personnages et d’objets de toutes sortes. Quand j’ai visité le Palais pour la première fois, c’est ce qui m’a le plus frappée. Puis, un jour, en lisant une chronologie, je me suis aperçue que c’était la partie par laquelle Cheval avait commencé. Il était fou, il était excité, il avait envie de tout dire, de tout raconter. Il n’y a aucune autre architecture que celle du délire. Ensuite, le Palais est beaucoup plus structuré, il avait organisé son travail, alors qu’au départ c’était une pulsion tellement forte que l’on sent qu’il ne pouvait faire autrement que de faire un chef d’œuvre. Pour moi, Cheval est un exemple extraordinaire, fabuleux, et la toile que j’ai faite sur le Palais Idéal ne pouvait être autre chose que ce qu’elle est. Il fallait qu’elle dépasse les limites des choses normales.
Q : Y-a-t-il des personnes qui vous ont dit qu’après avoir vu vos tableaux elles ont eu le désir de peindre ?
R : Non, je ne pense pas. Mais il m’est arrivé une aventure plus étrange que cela. Un jour, une rédactrice d’un magazine de mode américain voit un de mes tableaux intitulé « La Marchande de poissons » qui se trouvait dans une collection particulière. Elle a essayé de l’acheter par tous les moyens mais elle n’y est pas parvenue. Elle est retournée aux États-Unis, furieuse, et, quelques mois plus tard, j’ai appris qu’elle avait quitté sa place et qu’elle avait ouvert une poissonnerie à New York ! C’est pire que de devenir peintre, non ?
(à suivre…)

Martine Doytier, La Marchande de poissons, 1972, huile sur toile, 46 x 61 cm. Collection privée.
Q : Pourquoi faites-vous de la peinture ?
R : Actuellement, on a besoin de trouver une raison, une fonction, à chaque geste, à chaque mouvement que fait un artiste. Moi, je prétends, et c’est peut-être une des grandes dualités de ma personnalité, être quelqu’un de totalement irraisonnable et je refuse d’avoir une fonction et une situation déterminées.
Q : Je sais que vos tableaux exercent une sorte de fascination car j’en ai un exemple dans ma famille. Mes parents ont vu, il y a plusieurs années, un reportage sur vous à la télévision et ils ont vus vos tableaux. Eh bien, ils m’en parlent aujourd’hui encore, ils me parlent de vos personnages, de leurs grands yeux, et pourtant ils ne s’intéressent absolument pas à la peinture. Y-a-t-il eu une époque où vous ne peigniez pas ?
R : J’ai toujours peint. Depuis que je suis toute petite, l’activité la plus importante de ma vie à été le geste de dessiner, de peindre ou de faire de la poterie. Mais, il y a une dizaine d’années, en 1971 pour être plus précise, j’ai peint une toile qui annonçait celles que je fais aujourd’hui. Elle s’appelait Paradis terrestre et représentait Adam et Ève au milieu d’une jungle de végétation. C’est pour cela que je dis généralement que je peins depuis dix ans.
(à suivre)

Martine Doytier, Paradis terrestre, 1971, huile sur toile, 46 x 55 cm. Collection privée.
Q : Quels sont vos rapports avec les critiques d’art ?
R : Ce qui me hérisse le plus c’est toute la théorie, la critique, les élucubrations des autres. Qu’ils nous laissent donc faire ce qui nous plait sans y rajouter des mots, sans y rajouter leur sauce personnelle. Pourquoi les mots, leurs mots, au travers de la peinture ?
Q : En général, ce qui intéresse de nombreux artistes contemporains, c’est l’objet, le concept, la couleur, la matière, etc. Tandis que vous, vous réhabilitez le sujet.
R : Je refuse ce côté primaire, soi-disant analytique, qui est la manière la plus légère, la plus simpliste d’aborder la peinture. Je me suis appliquée, un jour, à lire un texte de Bernard Lamarche-Vadel et je me suis dit : « c’est seulement ça qu’il a voulu dire ! » J’ai trouvé ça très déprimant. Je trouve que cette attitude est prétentieuse, c’est essayer de placer l’individu hors de son cadre. Je trouve que l’être humain est la chose la plus intéressante, la plus puissante et la plus faible qui puisse exister et je n’ai pas envie d’analyser la couleur ou les éléments qui composent un tableau. Si seulement les peintres qui font cela faisaient avancer l’histoire de l’art, mais ils ne font qu’enfoncer des portes ouvertes il y a bien longtemps et par des artistes autrement plus novateurs. Moi, j’ai envie de parler d’une chose, c’est des individus. Je déteste la peinture de ceux qui oublient l’être humain.
Q : Quels sont vos rapports avec les autres peintres ?
R : La peinture des autres me dérange, me perturbe. J’ai suffisamment de difficultés à m’y retrouver moi-même alors je n’ai qu’une envie, c’est de jouer les autruches. Mais ce n’est pas un refus des autres, c’est une forme de préservation. En effet, si l’on regarde mes tableaux, on s’aperçoit que je ne fais que parler des autres. Alors, si j’ai des ami·es peintres c’est à cause de leur personnalité, non pas à cause de leur peinture.

Martine Doytier, Autoportrait, 1979-1984, huile sur toile, détail, partie basse du panneau de droite. Collection Ville de Nice – Donation Jean Ferrero.